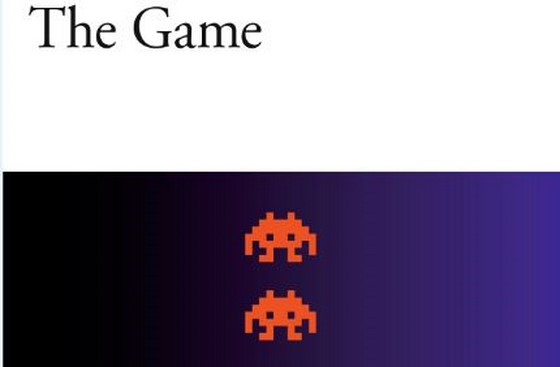« À l’époque, ce qui a retenu l’attention de tous – et suscité l’indignation de beaucoup – c’est le fait que les messages ne devaient pas dépasser cent-quarante caractères. En réalité, puisqu’il s’agissait de textos, c’était tout à fait normal, mais il était logique que la plupart des gens y voient un autre signe de l’apocalypse culturelle : il existait une humanité capable d’exprimer ses pensées en cent-quarante caractères. Des barbares. »
Avec « Next » puis avec « Les Barbares », Alessandro Baricco invitait à prendre du recul vis-à-vis des critiques et des réticences les plus fréquemment exprimées quant à certains points de l’évolution de la société. « The Game » poursuit dans la même veine. Dédramatiser le prodigieux essor du numérique, la manière dont il nous envahit, nous enserre, nous contraint à adopter ses modes, ses méthodes, ses pratiques, nous simplifie la vie nous aide, nous perturbe parfois nous effraie, tel est le but de cet ouvrage. Dédramatiser, mais pas seulement : Baricco cherche à emmener le lecteur avec lui, à lui faire partager l’exaltation et l’ivresse d’un monde nouveau.
« Nous savons avec certitude que nous nous orienterons avec des cartes qui n’existent pas encore, que nous aurons une idée de la beauté que nous ne savons pas prédire, et que nous nommerons vérité un réseau de figures qu’autrefois nous aurions considérées comme des mensonges. »
Pour ce faire, Alessandro Baricco dresse un tableau à la fois synoptique et emphatique, établit les grandes dates fondatrices de ce nouveau monde qu’il nomme le Game, et dessine les cartographies mentales successives, telles qu’elles se sont construites au fil des dernières décennies, de l’univers dans lequel nous vivons à présent. Le ton par moments excessivement vibrant ne tarde pas à convaincre le lecteur, non pas du fait que l’on vit à présent dans le meilleur des mondes, mais du fait que l’auteur est mû par l’ambition d’être celui qui aura écrit la nouvelle Odyssée, celle du monde nouveau, celle de la révolution numérique. Une odyssée servie par un esprit brillant (ce que l’on n’a jamais pu dénier à l’auteur), par des idées élégantes (ces cartographies témoignent de façon particulièrement démonstrative de l’emprise absolue du monde marchand, avec ses sommets ou bassins d’attraction que sont l’AppleStore et Amazon, même si, avec un peu de recul, on peut considérer de telles géographies comme quelque peu réductrices), et par un retour didactique et détaillé sur les grands jalons de l’histoire du monde numérique. Le talent est là : solidement documenté, « The Game » est avant tout raconté comme une histoire, et conçu pour être lu comme un roman. Conçu également pour être accessible à tout lecteur : ceux que l’histoire ou la sociologie rebutent y trouveront leur compte, ceux qui n’ont pas pris le monde numérique en marche en apprendront beaucoup.
« Nous sommes constamment sur le web c’est notre façon de vivre, de produire du sens, d’emmagasiner de l’expérience. En cela, nous constituons véritablement une humanité nouvelle, et nous l’étions déjà à l’aube de la révolution, lorsque, dans la lumière originelle de l’ère classique, nous avons jeté les bases de ce mouvement. »
De là à convaincre – on est bien souvent saisi par l’impression que l’auteur écrit pour faire adhérer le lecteur à ses vues, se laisse aller à un long tract argumenté, se fait le chantre des géants de la technologie pour l’avènement d’un monde meilleur, bref, est en campagne – il y a un pas. Il n’est pas besoin de prendre beaucoup de recul pour ne pas être dupe. Que ces technologies de communication permettent à tout un chacun de produire du sens et d’enrichir sa vie, comme l’affirme l’auteur, reste éminemment discutable. Entre écrire « Océan mer », comme Baricco l’a fait, et poster compulsivement ses photos de steak-frites et de pizzas, il y a une nuance que Baricco lui-même ne semble nullement prêt à reconnaître. La mise en ligne irréfléchie de tout et n’importe quoi sur des réseaux dits sociaux peut en effet donner à qui la pratique une excitation, une impression de créativité, mais n’a fondamentalement pas grand-chose à voir avec elle. Accumuler et poster des selfies de façon monomaniaque ne produit pas de sens. En faisant l’éloge de l’aliénation dans l’illusion, Baricco tente tant bien que mal d’entraîner avec lui son lecteur dans les mille et une déclinaisons de l’euphorie permise par les facilités du monde numérique.
Dans le même ordre d’idées – celui du quantitatif – on s’étonne quelque peu de lire un effarant discours promotionnel pour les plateformes commerciales. “Tout pour neuf euros et quatre-vingt-dix-neuf cents” : on n’est plus dans l’essai argumenté mais dans le pur relais publicitaire. L’auteur s’émerveille de ces accès illimités à la littérature et à la musique en ligne, comme s’il pouvait ignorer que l’on trouve partout en Europe – sinon ailleurs – des milliers de bibliothèques, de médiathèques et autres institutions où l’on peut avoir accès gratuitement à plus de livres que l’on n’en pourra jamais lire et à plus de musique que l’on n’en pourra jamais écouter. Mais pour Baricco, le vertige des grands nombres apparaît irrésistible. Plus que trop, c’est encore mieux.
Baricco se fait donc l’apôtre de la pléonexie – le toujours plus, le plus pour le plus – en occultant totalement ses effets dévastateurs sur le monde. Pas un mot sur l’envol énergétique délirant du monde numérique : les entrepôts de serveurs, les fermes de données, pour conserver chaque jour quelques millions ou milliards de photographies ou de séquences vidéos ineptes de plus, consomment une énergie elle aussi chaque jour croissante. Notre monde brûle ? Les réserves naturelles se tarissent ? Les populations animales et végétales s’effondrent ? Les catastrophes climatiques s’accumulent ? Pas un mot, pas une pensée de l’auteur pour qui, en gaspillant chaque jour un peu plus, nous avançons chaque jour dans un monde plus enchanteur.
Les machines nous disperseraient-elles ? Non, écrit l’auteur, sûr de lui : “C’est nous qui voulions avancer dans le monde d’un pas léger, c’est ce que nous voulions quand nous avons commencé cette révolution. La maison était en feu, il fallait la quitter au plus vite. Nous avions en tête un plan d’évasion et un système pour nous sauver. Et certains pouvaient apercevoir au loin la terre promise.” Joli tour de passe-passe permettant d’occulter ce présent-futur qui déjà partout commence, littéralement, à brûler, en expliquant que c’est le passé dont il faut faire table rase, parce que c’était lui qui brûlait. On reste perplexe en trouvant chez un lettré comme Baricco cette “haine du passé” dont parle souvent Quignard, cette détestation du « jadis » abondamment pratiquée par les régimes totalitaires. Tout détruire, rien de moins. Brûler ses vaisseaux, couper les ponts. L’exemple phare de Baricco l’écrivain – que l’on espère choisi à dessein et volontairement provocateur – c’est l’inutilité totale du subjonctif dont il faut tout oublier (comprendre : la pratique et la compréhension du langage ne sert à rien, et corollaire : la gymnastique mentale non plus, utiliser et entraîner son cerveau, c’était bon pour les générations précédentes, et encore, pas sûr.) La pratique du subjonctif demande une connaissance du langage et de ses finesses, elle suppose une compréhension de sa richesse, une pratique, une aptitude à la mémorisation, toutes choses, comprend-on, que l’auteur voudrait voir partir en fumée. À l’opposé, Baricco s’émerveille devant le fait que tout contemporain ait vu trente fois plus de films que son père au même âge. Avoir vu trente fois plus de films, pour l’auteur, c’est assurément autre chose que de pratiquer le subjonctif. On aura toute facilité à rétorquer que cela ne signifie aucunement qu’on les ait compris ou simplement gardés en mémoire. Que l’on en ait tiré ou conservé quoi que ce soit - ne serait-ce que d’un seul. Cela signifie pour beaucoup que l’on s’est assujetti à un certain nombre d’heures d’hypnose cathodique, et que l’on a offert aux publicités télévisées son quota voulu de « temps de cerveau disponible ». Dans le pré d’à côté, le ruminant contemporain voit passer trente fois plus de trains à grande vitesse que les générations précédentes. Est-il pour cette raison dans un monde meilleur ? Comprend-t-il mieux la nature des trains pour autant ?
On pourra trouver l’ironie facile. Mais il est vrai que la ferveur de l’auteur laisse pantois, que ses envolées lyriques étonnent. Plus d’une fois, on se demande s’il joue à se faire l’avocat du diable. Il est vrai qu’il lui arrive de pondérer ses propos, par exemple à l’occasion de sa théorie du plan incliné sur laquelle il revient à plusieurs reprises et selon laquelle il suffirait de faire rouler ses croyances pour les voir devenir des idées (“beaucoup d’entre eux tournent à vide, ils sillonnent à une vitesse admirable la surface du game sans pouvoir la rayer le moins du monde”), sur l’intelligence des élites émergentes (“à présent, pour masquer la rareté de la pensée, on a la vitesse, un certain brio apparent et une belle forme d’intensité”), sur le caractère superficiel de ce nouveau monde (belle formule de l’ivresse de l’étoile filante et de la feuille morte), mais ce ne sont là que des précautions oratoires, des éléments qui ressemblent aux contre-arguments passagers d’une rhétorique pernicieuse. Baricco semble comprendre que dans ce nouveau monde la répétition à l’infini de l’inanité devient une vérité mais ne semble pas vouloir en admettre les corollaires dévastateurs, comme le concept de post-vérité, la propagation facilitée de l’incitation à la haine, de la rumeur, des théories du complot, des révisionnismes, de la propagande, de la désinformation. Pas un mot non plus du formidable outil de pouvoir et de coercition qu’est déjà devenu ce monde numérique, un monde de surveillance à outrance où il n’y a plus besoin du Big Brother de George Orwell puisque chacun, avec le même enthousiasme que l’auteur, y est devenu son propre délateur. Toutes ces omissions génèrent un trouble certain, comme si tout entier à son éloge Baricco ne versait pas dans cette servitude volontaire, très classique, que décrivait Etienne de la Boétie, mais dans une véritable soumission enthousiaste. On serait tenté d’écrire que Baricco s’enivre de ses arguments populistes et de sa rhétorique frelatée de camelot. Il évoque certes des éléments contredisant ses thèses, mais les gomme, les efface, les oublie par un jeu de prestidigitateur auquel ne se laisseront prendre que les lecteurs les plus superficiels.
« Le patrimoine de savoir et d’intelligence qui les accompagnait depuis des siècles est trop souvent immobile en marge du système, non traduit dans le langage du présent, incompatible avec les habitudes les plus élémentaires des gens, trop lent pour se déplacer dans le Game et trop statique pour être enregistré par les radars du monde. Une sorte de fatalisme mêlé d’orgueil semble l’empêcher de se mettre en marche et une inertie désolante l’entraîne dans l’oubli. Bientôt nous ne nous rappellerons plus qu’il existe. Ainsi, les œuvres sont vivantes, mais souvent le récit que nous en faisons est muet. La beauté que nous ont laissé nos pères est fort désirée, mais presque impossible à trouver, car les cartes sont devenues illisibles. »
Nous parlions plus haut de servitude volontaire : on en trouvera plus d’un exemple à travers cet essai. Dans l’esprit de Baricco, un nouveau souverain est là, alors acclamons-le, et puisque nous n’avons pas le choix, convertissons-nous. Réécrivons avec enthousiasme l’histoire des vingt dernières années en leur donnant la valeur d’un mythe, c’est-à-dire en l’embellissant, en lui donnant une allure de pureté qu’elle n’a jamais eue. Donnons-lui la noblesse d’une révolution, faisons-là passer pour une vertueuse insurrection. Efforçons-nous de la conter à la façon d’une saga, d’une épopée façon chevaliers de la table ronde, révolution cubaine, utopie libertarienne. Faisons du présent un lendemain qui chante. Hélas, cette imagerie faussement naïve ressemble parfois trop à un conte pour enfants pour duper même les plus accommodants.
On comprend le propos de l’auteur : l’avènement de ce qu’il nomme le Game n’est sans doute pas l’apocalypse mentale attendue. Mais à trop vouloir forcer le trait, à trop vouloir défendre la thèse, l’honnêteté intellectuelle s’évapore. Défendre le progrès numérique, refuser de faire partie des contempteurs systématiques de toute nouveauté ne doit pas pour autant conduire à l’abolition de tout esprit critique. Et l’on passera rapidement sur bien des affirmations annexes, inconséquentes, malhonnêtes – les guerres mondiales étaient dues à un simple immobilisme et n’auraient jamais pu arriver avec le mouvement et la fluidité du Game, les camps d’extermination n’auraient pas été possibles avec Facebook (comme s’il n’y avait plus de guerres ni de massacres à l’ère de l’information, dans laquelle nous sommes tout de même depuis plusieurs décennies) – qui laisseront, au mieux, le lecteur consterné.
On reste donc réservé sur cette grande apologie euphorique, brillante – mais aussi souvent brillante dans la mauvaise foi – souvent discutable et toujours passionnante, mais grevée par le biais positif de son approche. En prenant le contrepied des prudences, des réticences, des recours modérés et raisonnés aux nouveaux outils et aux nouvelles facilités, mais en minimisant les impacts sur les capacités de raisonnement, en occultant à dessein les nouveaux types d’asservissement, de dépendances et d’infantilisations, Baricco force le trait. Mais peu importe : s’il ne parvient pas tout à fait à convaincre, « The Game » a au moins le mérite de faire réfléchir.
Titre : The Game (The Game, 2018)
Auteur : Alessandro Baricco
Traduction de l’italien : Vincent Raynaud
Couverture : Invaders of Space – Fontvir.us
Éditeur : Gallimard (édition originale : Gallimard,2019)
Collection : Folio
Site Internet : page roman (site éditeur)
Numéro : 6895
Pages : 410
Format (en cm) :11 x 18
Dépôt légal : décembre 2020
ISBN : 9782072921513
Prix : 8,60 €